
Le lobbying : définitions
Le lobbying : en pratique
Le lobbying peut se définir comme un ensemble d’actions coordonnées qui visent à exercer une influence ciblée sur les décideurs publics, en fournissant notamment des informations expertes et des analyses pour convaincre ces derniers de l’intérêt ou de l’inutilité d’une initiative.
Ces propositions et démarches s’inscrivent dans le strict respect des institutions démocratiques, sans contrainte ni obligation, mais avec l’objectif de susciter une adhésion éclairée et volontaire. Par le biais d’arguments et de données, le lobbying cherche ainsi à démontrer l’importance ou l’inefficacité potentielle d’une mesure politique, législative, réglementaire ou administrative.
Il s’agit donc d’un dialogue constructif, respectueux des règles et des institutions, où les acteurs privés ou associatifs, en leur qualité de parties prenantes, s’efforcent de partager leur expertise, de défendre leurs intérêts et de faire valoir des points de vue au profit d’une décision publique mieux informée et plus réfléchie.
Le lobbying est un travail d’argumentation, de persuasion et de défense d’intérêts. C’est pourquoi la principale qualité du lobbyiste va être, dans un cadre constitutionnel contraint (l’organisation des pouvoirs publics), de réussir à persuader les acteurs clés du jeu institutionnel de la justesse de ses arguments comme de la pertinence de ses propositions.
La définition la plus exacte du lobbyiste est donc celle d’un plaideur, un plaideur d’un genre particulier puisqu’il intervient devant les pouvoirs publics et les élus. Plaider devant les pouvoirs publics, c’est dans une démocratie parlementaire, intervenir devant des institutions organisées par une constitution représentée par des personnes démocratiquement élues.
Cette plaidoirie s’exerce dans le cadre de l’ensemble des normes supérieures qui s’imposent à tous les citoyens et des lois organiques qui organisent le fonctionnement des pouvoirs publics. Le lobbyiste va donc organiser sa mission d’influence et de conviction selon les règles institutionnelles qui s’imposent à tous.
Le lobbying en droit : la loi « Sapin 2 » et son décret
En droit, selon l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, tel qu’il est mentionné sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), le lobbying, ou représentation d’intérêts, consiste en des actions visant à « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication » avec l’un des responsables publics désignés dans cet article. Ce cadre juridique précise donc que toute personne ou entité cherchant à orienter, par le dialogue et l’interaction, les décisions des pouvoirs publics en matière de législation ou de régulation, entre dans le champ de la représentation d’intérêts lorsqu’elle engage des échanges avec des responsables publics.
En complément, l’article 1er du décret du 9 mai 2017 apporte des précisions sur la nature de cette communication, en disposant que l’initiative doit venir du représentant d’intérêts. Il détaille également les types de communications qui, en raison de leur nature, ne sont pas considérées comme des actions de représentation d’intérêts. Ainsi, ce décret clarifie les interactions qui ne relèvent pas du lobbying au sens de la loi, excluant notamment certaines communications jugées accessoires ou sans incidence directe sur les décisions des pouvoirs publics.
Le lobbying consiste ainsi à influer :
I : en entrant en communication :
- en organisant des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;
- en convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique ;
- en Invitant ou en organisant des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles ;
- en établissant une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;
- en envoyant des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;
- en organisant des débats publics, des marches, des stratégies d’influence sur internet ;
- en organisant des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d’autres consultations ouvertes ;
- en transmettant des suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ;
- en transmettant aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ;
II : à titre principal ou régulier :
- soit plus de 50% de son temps ;
- soit plus de10 contacts par an ;
III : sur une décision publique :
- Lois, y compris constitutionnelles ;
- Ordonnances de l’article 38 de la Constitution ;
- Actes réglementaires ;
- Actes unilatéraux ;
- Concessions de service public
- Décisions relations entre le public et l’administration
- Contrats de marchés publics, (valeur supérieure ou égale aux seuils européens) ;
- Délibérations relatives aux sociétés d’économie mixte ;
Sauf :
- Autorisation administrative à laquelle on est éligible ;
- Recours administratif ;
IV : avec certaines personnes, les décideurs publics :
- Membres du Gouvernement ou membres de cabinet ministériel ou collaborateur du Président ;
- Responsables des autorités administratives indépendantes et autorités administratives indépendantes ;
- Responsables locaux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement ;
- Règles au sein de chaque assemblée parlementaire selon ordonnance de 1958 + déontologue ;
Le lobbyiste ou représentant d’intérêts
De l’ensemble de ces dispositions, il ressort qu’une personne peut être qualifiée de représentant d’intérêt ou de lobbyiste lorsque deux conditions sont cumulativement remplies.
Premièrement, il y a le critère organique, qui se réfère au statut de la personne ou de l’entité concernée : elle doit agir dans un cadre défini pour être considérée comme un acteur institutionnel ou privé ayant des intérêts à promouvoir.
Deuxièmement, le critère matériel se rapporte aux activités menées : celles-ci doivent viser à influencer les décisions publiques de manière proactive. La combinaison de ces deux critères – statut et actions – est donc essentielle pour déterminer si une personne ou une organisation entre dans la catégorie des représentants d’intérêts.
Le représentant d’intérêt est donc :
- Soit une personne physique qui exerce à titre individuel cette activité professionnelle
- Soit le dirigeant, l’employé ou le membre :
- d’une personne morale de droit privé ;
- d’un établissement public ou d’un groupement public exerçant une activité industrielle et commerciale ;
- d’une chambre de commerce et de l’industrie ;
- mais il n’est pas :
- les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
- les partis et groupements politiques dans le cadre de leur mission ;
- les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs dans le cadre de leur mandat ;
- les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.
Pour aller plus loin :
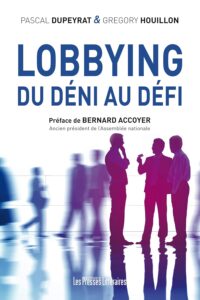
Titre : Lobbying : du déni au défi
Auteurs : Pascal Dupeyrat, Grégory Houillon
Éditeur : Les Presses Littéraires
Date de parution : 29 septembre 2017
Langue : Français
Type : Livre broché
Pages : 154
Dimensions : 16 x 1 x 24 cm
Poids : 286 g
ISBN-13 : 979-1031003412
ASIN : B07628KNS2
Notre expertise
Relians, cabinet de lobbying et d’affaires publiques
