
Contrôle des investissements étrangers en France en 2024 : rapport annuel 2025
La publication du rapport annuel 2025 sur le contrôle des investissements étrangers en France en 2024 par la Direction générale du Trésor offre un éclairage précis sur l’évolution de ce dispositif stratégique. En s’appuyant sur des données consolidées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, le rapport met en évidence les tendances, les secteurs les plus concernés, ainsi que la manière dont les autorités françaises veillent à concilier attractivité économique et préservation des intérêts fondamentaux de la Nation.
Contexte et enjeux de souveraineté économique
L’année 2024 a confirmé la nécessité pour la France de renforcer son controle des investissements étrangers. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et une compétition économique mondiale accrue, la protection des secteurs stratégiques et des savoir-faire sensibles est au cœur des priorités de l’État.
Le dispositif français s’est consolidé au fil des années pour couvrir non seulement la défense et la sécurité nationale, mais aussi l’énergie, la santé publique, la sécurité alimentaire, les infrastructures critiques et la recherche en technologies de pointe. L’objectif principal du contrôle des investissements étrangers est de préserver la souveraineté économique tout en maintenant l’attractivité du territoire pour les capitaux internationaux.
Évolutions et chiffres clés en 2024
En 2024, 392 dossiers ont été déposés au titre du contrôle des investissements étrangers, contre 309 en 2023, traduisant une hausse de l’activité. Sur ces dossiers, 337 décisions ont été rendues :
-
182 autorisations ont été délivrées, dont 99 assorties de conditions pour protéger les intérêts nationaux.
-
73 % des demandes d’examen préalable ont conclu à l’inéligibilité au dispositif.
-
6 refus ont été prononcés sur trois ans, souvent précédés de retraits spontanés des investisseurs face aux conditions envisagées.
La majorité des opérations concernait les infrastructures, biens ou services essentiels, suivies par les activités de recherche et de développement en technologies critiques, comme la cybersécurité, les biotechnologies ou les semi-conducteurs. L’origine des investisseurs reste majoritairement non européenne (65 %), avec en tête les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse.
Ces chiffres démontrent que le contrôle des investissements étrangers reste un instrument actif, mais proportionné, combinant attractivité et sécurité économique.
Processus et conditions du contrôle
Le controle des investissements étrangers repose sur un processus en deux phases :
-
Phase 1 (30 jours ouvrés) : analyse préliminaire par la Direction générale du Trésor et le Comité interministériel des investissements étrangers en France (CIIEF).
-
Phase 2 (45 jours ouvrés supplémentaires) : examen approfondi en cas de risque identifié pour l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
Les autorisations peuvent être simples ou assorties de conditions. En 2024, 54 % des autorisations ont été conditionnelles. Ces conditions visent notamment à :
-
Assurer la continuité des activités stratégiques sur le territoire national.
-
Protéger les savoirs et savoir-faire sensibles.
-
Encadrer la gouvernance et les droits de vote des investisseurs.
-
Maintenir l’information régulière de l’État sur le respect des obligations.
Un mécanisme de révision des conditions existe en cas d’évolution des circonstances économiques, réglementaires ou actionnariales. En 2024, huit demandes de révision ont été traitées, dont sept acceptées.
Focus sur les secteurs sensibles
Le rapport met en évidence la place croissante des technologies critiques dans le controle des investissements étrangers :
-
Les biotechnologies et la santé représentent une part majeure des opérations contrôlées.
-
La cybersécurité, les semi-conducteurs, la robotique et les technologies « bas carbone » font l’objet d’une vigilance accrue.
-
Les activités de R&D sont désormais intégrées au champ du contrôle, même avant la phase de production industrielle.
De plus, le controle des investissements étrangers s’applique aussi aux entreprises en difficulté. En 2024, 17 décisions ont concerné des sociétés en procédure collective. La coopération avec le CIRI, la DIRE et les administrateurs judiciaires a permis d’adapter les délais pour concilier rapidité et protection des intérêts nationaux.
Dimension européenne et internationale
Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen (UE) 2019/452, la France participe activement au mécanisme de coopération sur le filtrage des investissements directs étrangers. En 2024 :
-
La Commission européenne et les États membres ont échangé sur 1 808 opérations.
-
Les notifications françaises ont contribué à renforcer la transparence et la protection collective au niveau européen.
-
Une révision du règlement est en cours, visant à doter tous les États membres d’un dispositif national de controle des investissements étrangers et à optimiser la coopération.
La France, par la voix de la Direction générale du Trésor, joue un rôle moteur dans ce processus, représentant le pays au sein du G7 et dans les groupes de travail de l’Union européenne.
Conclusion et perspectives
Le rapport 2025 confirme que le controle des investissements étrangers en 2024 est désormais un pilier de la politique de souveraineté économique française. L’augmentation du nombre de dossiers traités, la proportion d’autorisations sous conditions et la vigilance portée aux secteurs stratégiques montrent l’efficacité d’un dispositif à la fois protecteur et attractif.
En 2025, les priorités porteront sur :
-
La publication de nouvelles lignes directrices pour renforcer la lisibilité du cadre réglementaire.
-
L’adaptation des conditions d’autorisation à l’évolution des technologies critiques et des enjeux géopolitiques.
-
Le renforcement du rôle de la France dans la coordination européenne du contrôle des investissements étrangers.
Par cette approche équilibrée, la France entend rester une destination de choix pour les investisseurs, tout en préservant l’intégrité de ses intérêts nationaux et de ses chaînes de valeur stratégiques.
Pour rappel : synthèse comparative des rapports IEF 2021-2023
Entre 2021 et 2023, les rapports annuels publiés par la direction générale du Trésor témoignent d’une intensification progressive de ce contrôle, marquée à la fois par un renforcement du périmètre réglementaire et par une structuration plus fine des procédures d’instruction et de suivi des opérations sensibles.
Sur la période, plusieurs tendances fortes émergent :
- Stabilité du nombre de dossiers traités, mais augmentation de la proportion des autorisations sous conditions.
- Accentuation de la part des investisseurs non européens parmi les opérations contrôlées.
- Élargissement progressif du champ d’application sectoriel, intégrant des domaines comme les biotechnologies, les énergies renouvelables, les matières premières critiques et la photonique.
- Maturation des outils procéduraux et numériques, avec la publication de lignes directrices et la mise en place de la plateforme IEF.
L’examen chronologique et comparatif des données clés permet de mesurer l’évolution de l’efficacité et de l’ambition du contrôle des investissements étrangers en France.
Évolution quantitative et qualitative du contrôle IEF
Nombre de dossiers et décisions rendues
- 2021 : 328 dossiers déposés, 124 autorisations, dont 67 assorties de conditions (54 %).
- 2022 : 325 dossiers, 131 autorisations, dont 70 sous conditions (53 %).
- 2023 : 309 dossiers, 135 autorisations, dont 60 sous conditions (44 %).
Ces chiffres indiquent une relative stabilité du volume de dossiers soumis au contrôle des investissements étrangers en France, malgré un léger reflux en 2023. La proportion d’autorisations sous conditions, en revanche, diminue légèrement en 2023, traduisant un ajustement entre vigilance et proportionnalité des décisions.
La baisse du nombre de demandes d’examen préalable (41 en 2021, 42 en 2022, 27 en 2023) suggère que les investisseurs étrangers maîtrisent de mieux en mieux le champ d’application du dispositif, notamment grâce aux FAQ, lignes directrices et échanges en amont avec le Trésor.
Origine des investisseurs ultimes
La prépondérance des investisseurs non européens se confirme sur la période :
- 2021 : 58,8 % hors UE/EEE
- 2022 : 65,8 % hors UE/EEE
- 2023 : 67,3 % hors UE/EEE
Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada restent les trois premières sources de capitaux pour les opérations soumises au contrôle des investissements étrangers en France, avec des investisseurs allemands et luxembourgeois en tête côté européen. Cette répartition illustre la sensibilité croissante du dispositif face aux flux extra-européens, tout en respectant le principe d’ouverture aux IDE lorsque la sécurité nationale n’est pas menacée.
Répartition sectorielle
L’évolution sectorielle des autorisations illustre l’adaptation continue du périmètre du contrôle :
- 2021 :
- Défense et activités sensibles par nature : 13,7 %
- Infrastructures, biens et services essentiels : 56,9 %
- Mixte : 29,4 %
- 2022 :
- Sensibles par nature : 23,7 %
- Essentiels : 51,9 %
- Mixte : 24,4 %
- 2023 :
- Sensibles par nature : 21,5 %
- Essentiels : 63,7 %
- Mixte : 14,8 %
Cette dynamique met en évidence une civilisation progressive du contrôle, avec une part croissante des investissements liés aux infrastructures critiques et aux chaînes d’approvisionnement stratégiques (énergie, transport, santé, sécurité alimentaire).
Évolutions réglementaires majeures
2021 : Adaptation à la crise sanitaire
Le rapport 2021 souligne la mise en place de mesures temporaires pour protéger les sociétés cotées françaises :
- Abaissement à 10 % du seuil de détention des droits de vote pour déclencher le contrôle des investissements étrangers en France par un investisseur hors UE/EEE.
- Extension du périmètre aux biotechnologies, pour sécuriser les activités de R&D liées à la santé publique.
Ces mesures illustrent la réactivité du dispositif face aux risques d’acquisitions opportunistes dans un contexte de fragilité économique.
2022 : Stabilisation et clarification
En 2022, l’accent est mis sur la sécurité juridique et la transparence :
- Publication des lignes directrices IEF en septembre 2022.
- Prorogation du seuil de 10 % jusqu’au 31 décembre 2023.
- Formalisation d’une procédure en deux phases (30 + 45 jours) et renforcement du suivi des conditions imposées aux investisseurs.
Cette année marque une volonté de concilier ouverture économique et clarté du contrôle des investissements étrangers en France pour les parties prenantes internationales.
2023 : Consolidation et extension
L’année 2023 constitue une année charnière :
- Pérennisation du seuil de 10 % pour les sociétés cotées françaises.
- Extension aux succursales de sociétés de droit étranger inscrites au RCS français.
- Inclusion de nouveaux secteurs :
- Extraction, transformation et recyclage des matières premières critiques.
- Technologies bas-carbone et photonique.
- Sécurité des établissements pénitentiaires.
- Lancement de la Plateforme IEF, pour dématérialiser et accélérer le dépôt et le suivi des dossiers.
Ces ajustements confirment que le contrôle des investissements étrangers en France n’est pas figé mais évolutif, adapté aux transformations géopolitiques et technologiques.
Dimension européenne et internationale
La France a été moteur dans la mise en place du règlement (UE) 2019/452 et du mécanisme de coopération européenne. Entre 2021 et 2023, le rôle du Trésor s’est affirmé :
- 2021 : première année pleine de coopération, 108 notifications françaises.
- 2022 : renforcement du réseau et participation active aux avis et commentaires.
- 2023 : anticipation de l’évolution du règlement et soutien à l’harmonisation des critères de filtrage.
Cette dynamique européenne est essentielle pour la cohérence du contrôle des investissements étrangers en France, qui ne peut être isolé des flux transfrontaliers de capitaux.
Analyse comparative et prospective
L’analyse des trois rapports fait ressortir :
- Montée en maturité : l’administration maîtrise désormais un volume stable de dossiers et gère le suivi post-autorisation avec un meilleur outillage.
- Raffinement sectoriel : l’évolution vers des secteurs civils stratégiques montre que la sécurité économique est indissociable de la sécurité nationale.
- Renforcement procédural : la plateforme IEF et les lignes directrices améliorent la prévisibilité du dispositif pour les investisseurs.
- Projection 2024-2025 : l’intégration des matières premières critiques et des technologies bas-carbone laisse entrevoir un contrôle encore plus lié aux transitions énergétiques et numériques.
En somme, le contrôle des investissements étrangers en France est devenu un instrument pivot de souveraineté économique, combinant attractivité des IDE et protection des intérêts stratégiques.
Entre 2021 et 2023, la France a construit un dispositif de contrôle des investissements étrangers en France à la fois robuste, agile et lisible, aligné avec les standards européens et les meilleures pratiques internationales.
Le rapport 2025 sur le contrôle IEF en 2024 disponible sur
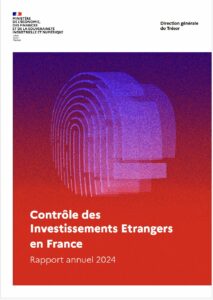
Pour en savoir plus
Livre « IEF Le contrôle des investissements étrangers en France », ed Relians, 2024
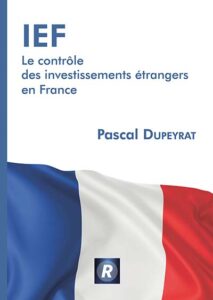
Notre expertise
Relians, cabinet de conseil stratégique et institutionnel, accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises confrontées à ces enjeux. En s’appuyant sur une lecture experte des textes, des pratiques administratives et des lignes directrices applicables, nous aidons nos clients à structurer leurs opérations en toute sécurité, dans le respect des exigences réglementaires et dans une logique de dialogue constructif avec les autorités françaises.
Relians, spécialiste du contrôle des investissements étrangers

