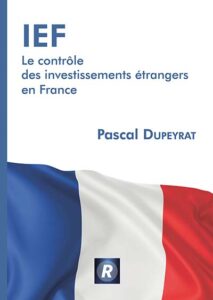Le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) constitue l’une des pierres angulaires de la souveraineté économique nationale. En confiant la supervision de ce mécanisme au ministère de l’Économie et des finances, le législateur a fait un choix symbolique et pratique : placer la liberté d’entreprendre au cœur du dispositif tout en garantissant que l’intérêt national prime lorsque certains secteurs stratégiques sont concernés. Il convient de conduite une analyse détaillée et contextualisée de ce choix institutionnel, de son évolution et de ses perspectives, afin d’éclairer la manière dont la France équilibre ouverture économique et protection de ses actifs essentiels.
La DG Tresor : une filiation libérale assumée
La première question qui se pose est celle du portage politique d’un contrôle des investissements étrangers en France (IEF) a priori conçu comme restrictif : pourquoi, en France, la police des investissements étrangers dépend-elle du ministre chargé de l’Économie plutôt que, par exemple, du ministre des Armées ou de celui de l’Intérieur ? La réponse tient à l’histoire économique de la Ve République et, plus largement, à la tradition libérale qui prévaut dans les grandes démocraties industrielles. L’ADN du ministère de l’Économie est d’abord la promotion de la liberté d’investir ; sa culture administrative est tournée vers l’attractivité, la compétitivité et la croissance.
En procédant ainsi, la France s’inspire des États-Unis, où le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) est piloté par le Treasury Department, ou encore l’Allemagne, où la compétence relève du ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat. Le message adressé aux investisseurs est clair : la porte est ouverte, mais un contrôle existe pour les activités susceptibles de toucher à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à des secteurs jugés sensibles. La « tonalité » du dialogue avec l’investisseur étranger reste donc économique ; elle n’est pas dominée par la logique régalienne, même si celle-ci demeure présente en arrière-plan.
La Direction générale du Trésor, pivot du dispositif
Au sein du ministère, la Direction générale du Trésor (DGT) joue un rôle de premier plan. Véritable vigie de la politique économique extérieure, la DGT possède la compétence technique nécessaire pour analyser les chaînes de valeur, mesurer l’impact d’une prise de contrôle et en apprécier la soutenabilité financière. L’arrêté du 18 décembre 2019, qui restructure ses services, consacre cette prééminence en attribuant expressément à la sous-direction de la politique commerciale, de l’investissement et de la lutte contre la criminalité financière la mise en œuvre du contrôle IEF.
L’argumentaire avancé par la DGT est double. D’une part, seule une connaissance fine du tissu productif permet d’identifier les risques réels derrière un investisseur donné ; d’autre part, un contrôle efficace des investissements étrangers en France (IEF) suppose de comprendre les besoins de financement des entreprises françaises pour ne pas bloquer, par précaution excessive, des opérations vitales pour leur croissance. En plaçant la barrière de sécurité au sein même du guichet économique, le gouvernement veut éviter l’écueil d’une bureaucratie hostile qui découragerait les capitaux étrangers tout en s’assurant que les dossiers sensibles soient traités avec la rigueur nécessaire.
Le SISSE : des radars en amont
Complément indispensable à la DGT, le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), rattaché à la Direction générale des Entreprises, assure une veille permanente. Créé en 2016 comme service à compétence nationale, le SISSE détecte les signaux faibles : un fonds étranger qui multiplie les tours de table en France, la mise sur le marché d’une PME détentrice de brevets sensibles, ou encore l’émergence d’une technologie duale pouvant avoir des usages civils et militaires. Dès qu’une opération potentiellement soumise au investissements étrangers en France (IEF) est repérée, le SISSE alerte la DGT, déclenchant une phase pré-contentieuse où l’entreprise cible peut être sensibilisée aux enjeux de souveraineté économique.
La naissance du bureau CIEF au sein de la DG Tresor et l’« effet PACTE »
La loi PACTE de 2019, en plus d’avoir réformé le droit des sociétés, a durci et modernisé le contrôle des investissements étrangers. Pour absorber la hausse du nombre de dossiers – multiplication par trois en quelques années – un bureau dédié a été créé en janvier 2019. Officiellement baptisé « CIEF » (Contrôle des investissements étrangers en France) à l’automne suivant, il compte aujourd’hui plusieurs équipes pluridisciplinaires composées d’économistes, de juristes et d’ingénieurs. Leur mission : instruire les demandes d’autorisation, préparer les projets de décision du ministre de l’Économie et assurer le secrétariat du Comité interministériel des investissements étrangers en France (CIIEF).
Le CIEF n’agit pas seul. Il déclenche une consultation interministérielle dès réception d’un dossier. Chacun examine l’opération sous l’angle de ses compétences : le ministère des Armées pour les questions de défense, le ministère de la Transition écologique pour les infrastructures énergétiques, l’ANSSI pour la cybersécurité, etc. Ce travail collégial, à la fois dense et rapide, garantit une appréciation globale des risques.
Une procédure en trois temps
L’instruction d’un dossier IEF obéit généralement à une chronologie en trois actes :
- Admissibilité : le CIEF vérifie d’abord si l’opération relève du champ défini par le Code monétaire et financier. Certaines activités – armements, cryptologie, infrastructures critiques, IA, etc. – déclenchent automatiquement le filtrage.
- Analyse de sensibilité : les services compétents déterminent si les risques identifiés justifient des conditions ou, dans les cas extrêmes, un refus. Le principe de proportionnalité est central : l’objectif n’est pas de proscrire mais de sécuriser.
- Décision motivée : le ministre signe une autorisation simple, une autorisation conditionnelle (accompagnée d’une lettre d’engagement) ou une interdiction. Les engagements peuvent porter sur la localisation de la R & D, la pérennité des capacités industrielles en France, la gouvernance des données ou encore la composition du conseil d’administration.
Les engagements et leur suivi
Une fois l’autorisation délivrée, l’enjeu majeur devient le suivi. Les investisseurs s’engagent, par exemple, à conserver en France des emplois, à notifier toute cession ultérieure ou à permettre à l’État un droit de veto sur certaines décisions stratégiques. Le CIIEF, avec l’appui du SISSE, surveille l’exécution de ces obligations à travers plusieurs outils : rapports annuels, réunions de suivi, visites sur site. En cas de suspicion de manquement, une procédure contradictoire est ouverte. Le spectre des sanctions va de l’injonction de se mettre en conformité à l’amende administrative, voire, dans les cas extrêmes, à la cession forcée des actifs.
Une interministérialité de la procédure
Le caractère collégial de la procédure de contrôle des investissements étrangers en France (IEF) a souvent été mis en avant par le Parlement. Qu’il s’agisse de la commission d’enquête sur la politique industrielle de 2023 ou, plus récemment, de la mission d’évaluation et de contrôle de 2025, les rapporteurs ont souligné l’efficacité d’une approche associant une trentaine d’agents issus de douze ministères et agences. Cette organisation empêche qu’un enjeu crucial pour la sécurité économique soit traité dans un silo administratif. Elle garantit également une réactivité remarquable : la phase d’examen initial dure trente jours ; si des approfondissements sont nécessaires, une seconde phase de quarante-cinq jours peut être déclenchée. Au total, la décision intervient donc, sauf complexité majeure, en moins de trois mois.
Une représentation européenne et internationale
Depuis octobre 2020, le règlement européen sur le filtrage des investissements directs étrangers prévoit une coopération renforcée entre États membres. Le CIEF est le point de contact national pour la France. Il transmet, quand c’est requis, les informations sur une opération donnée aux homologues européens et peut lui-même solliciter des éclairages sur des acquisitions françaises à l’étranger. À l’international, la France participe aux travaux de l’OCDE, de la CNUCED et du G7 sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement et la résilience industrielle.
Limitations et perspectives
Aussi robuste soit-il, le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France (IEF) n’est pas exempt de défis. La globalisation financière brouille parfois la traçabilité du capital. Les montages juridiques complexes, les entités écrans et l’extraterritorialité de certains droits étrangers compliquent l’analyse. En outre, la montée des tensions géopolitiques élargit sans cesse la liste des secteurs critiques : au-delà de la défense, on s’intéresse aujourd’hui au quantique, à la santé numérique ou à l’agritech. Face à ces mutations, le ministère entend à la fois renforcer les effectifs du CIEF et doter le SISSE d’outils de data-science afin de détecter plus tôt les signaux faibles.
La DG Tresor : trouver un équilibre subtil
En définitive, le choix de confier la police des investissements étrangers en France (IEF) au ministère de l’Économie reflète une certaine idée du rapport entre l’État et le marché. Il témoigne d’une confiance dans l’ouverture, doublée d’une vigilance accrue lorsque l’intérêt national est en jeu. Le binôme DGT–SISSE assure la détection et l’analyse économique, tandis que l’interministérialité garantit la prise en compte de toutes les composantes de la sécurité. Cette architecture flexible, étoffée par la réforme PACTE, constitue un standard de référence en Europe.
D’une liste indicative à un socle juridique robuste
Pour mesurer le chemin parcouru, il faut se souvenir qu’à l’origine, en 1966, le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) prenait la forme d’une simple déclaration à la Banque de France. Les premières restrictions véritables n’apparaissent qu’en 1999, dans un contexte de privatisations massives. La liste des secteurs sensibles était alors courte : armement, cryptologie, interception des communications. Tout change en 2005, après la tentative d’OPA de PepsiCo sur Danone, lorsqu’un décret – dit « décret de Villepin » – étend la protection à onze secteurs, dont l’énergie et l’eau. La crise financière de 2008 puis l’affaire Alstom-GE en 2014 alimentent un nouveau tour de vis, jusqu’à l’adoption des textes PACTE de 2019. Aujourd’hui, l’IEF repose sur une base législative solide, consolidée par des décrets d’application et régulièrement mise à jour pour intégrer les technologies émergentes.
Les pouvoirs de sanction : un arsenal gradué
Qu’advient-il si un investisseur omet de notifier une opération ou ne respecte pas ses engagements ? Le Code monétaire et financier prévoit un éventail de sanctions graduées en matiere de controle des investissements étrangers en France (IEF) . L’amende administrative peut atteindre le double de la valeur de l’investissement non autorisé. En cas de récidive ou d’atteinte grave aux intérêts nationaux, le ministre peut ordonner la cession forcée des titres acquis. Ces mesures, bien que rarement appliquées afin de préserver l’attractivité, suffisent le plus souvent à inciter les opérateurs à une transparence totale. La crédibilité de l’arsenal répressif renforce ainsi l’efficacité préventive du contrôle.
Transparence et dialogue avec le Parlement
Depuis 2019, le gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport anonymisé synthétisant le nombre de dossiers instruits, les délais moyens, le pourcentage d’autorisations conditionnelles et la typologie des engagements imposés. Si les détails commercialement sensibles demeurent protégés, cette transparence renforce la légitimité du dispositif. À plusieurs reprises, les commissions des finances et des affaires économiques ont auditionné les responsables du CIEF, soulignant l’importance d’un retour d’expérience pour ajuster le curseur entre attractivité et protection.
Pour en savoir plus
Notre expertise
Relians, cabinet de conseil stratégique et institutionnel, accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises confrontées aux enjeux des investissements étrangers en France (IEF) . En s’appuyant sur une lecture experte des textes, des pratiques administratives et des lignes directrices applicables, nous aidons nos clients à structurer leurs opérations en toute sécurité, dans le respect des exigences réglementaires et dans une logique de dialogue constructif avec les autorités françaises.
Relians, spécialiste du contrôle des investissements étrangers