
Article L151-3 du Code monétaire et financier – contrôle des investissements étrangers en France (IEF)
L’article L151-3 du Code monétaire et financier : pierre angulaire du contrôle des investissements étrangers en France (IEF)
Le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) repose sur un fondement juridique clair : l’article L151-3 du Code monétaire et financier. Ce texte occupe une place centrale dans l’architecture réglementaire française destinée à concilier l’ouverture de l’économie nationale avec la préservation des intérêts fondamentaux du pays. Héritier d’une tradition juridique remontant à la loi du 25 décembre 1966, l’article L151-3 du Code monétaire et financier symbolise à la fois la liberté des flux de capitaux et les limites que l’État peut poser à cette liberté au nom de l’intérêt national.
La liberté des relations financières comme principe fondateur
Depuis 1966, les relations financières entre la France et l’étranger sont juridiquement libres. L’article L151-1 du Code monétaire et financier, issu de l’article 1er de la loi du 25 décembre 1966, dispose que « les relations financières entre la France et l’étranger sont libres. Cette liberté s’exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France ».
Cette disposition marque une rupture nette avec les restrictions antérieures aux mouvements de capitaux et traduit une volonté d’intégration économique dans un contexte de mondialisation croissante. La libéralisation opérée entre 1966 et 1996 a permis à la France de se conformer à ses engagements européens et internationaux, notamment ceux pris dans le cadre de l’OCDE. Le renforcement de la libre circulation des capitaux, perçue comme vecteur de croissance et de compétitivité, est ainsi devenu un impératif de politique économique.
Une dérogation essentielle : la protection des intérêts fondamentaux
Cependant, cette liberté n’est pas absolue. L’article L151-3 du Code monétaire et financier contient une disposition dérogatoire permettant à l’État de subordonner certains investissements étrangers à une autorisation préalable, lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. Cette exception, introduite dès l’origine dans la loi de 1966, souligne que la liberté d’investir ne saurait primer sur la souveraineté nationale.
Le texte précise que « le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux, soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle la constitution ou la liquidation d’investissements étrangers en France ». L’article L151-3 du Code monétaire et financier consacre ainsi une dérogation à la liberté d’investissement des étrangers, placé sous l’autorité du pouvoir exécutif.
La notion d’ »intérêts nationaux » : une souveraineté préservée
L’un des aspects les plus marquants de l’article L151-3 du Code monétaire et financier réside dans la latitude qu’il accorde aux autorités françaises pour définir les mesures de contrôle applicables. Cette marge d’appréciation repose sur une interprétation souple et évolutive des « intérêts nationaux », notion volontairement non définie de manière restrictive dans la loi.
Les débats parlementaires de 1966 soulignent que cette absence de définition rigide visait à garantir au gouvernement une capacité d’action étendue, sans se voir enfermé dans un cadre juridique trop contraignant. Le rapport du Sénat de l’époque évoquait déjà les risques de « colonisation des secteurs vitaux de notre économie », justifiant la création d’un dispositif de filtrage des investissements étrangers.
Une articulation moderne : l’extension du contrôle à des secteurs stratégiques
Depuis 2014, et plus encore depuis la loi PACTE de 2019, l’article L151-3 du Code monétaire et financier a servi de fondemant pour s’adapter aux réalités géopolitiques et technologiques contemporaines. Dans un contexte de compétition accrue entre puissances économiques, le législateur a étendu le périmètre du contrôle à des secteurs sensibles tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, les infrastructures de données ou encore la production de vaccins.
La notion d’activité sensible, au sens de l’article L151-3 du Code monétaire et financier, vise toute activité participant même à titre occasionnel à l’exercice de l’autorité publique, ou susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. Elle inclut également la recherche, la production ou la commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
Une compétence centralisée : le rôle du ministre de l’Économie
L’architecture du contrôle repose sur une instruction centralisée des dossiers par la direction générale du Trésor, sous l’autorité du ministre de l’Économie. Conformément à l’article L151-3 du Code monétaire et financier, ce dernier dispose du pouvoir de délivrer, refuser ou conditionner une autorisation d’investissement. En cas de menace avérée pour les intérêts nationaux, l’autorisation peut être assortie de mesures conservatoires, voire être refusée.
Cette approche centralisée se donne comme objectif d’assurer une cohérence dans le traitement des dossiers et permet une appréciation globale des enjeux de sécurité économique. Elle évite également les risques de décisions fragmentées ou contradictoires.
Un outil stratégique au cœur de la souveraineté économique
Loin de constituer un frein à l’attractivité de la France, le dispositif fondé sur l’article L151-3 du Code monétaire et financier est aujourd’hui perçu comme un instrument juridique clé permettant de filtrer les investissements sensibles sans remettre en cause l’ouverture générale de l’économie.
Les chiffres récents montrent d’ailleurs une croissance continue du nombre de dossiers traités : 309 dossiers ont été examinés en 2023 selon le dernier rapport du ministère de l’Économie. Cette activité témoigne de la vigilance accrue des autorités françaises, dans un monde où les logiques de puissance, d’influence et de prédation économique se font plus pressantes.
Une compatibilité assumée avec le droit européen
L’article L151-3 du Code monétaire et financier est conçu pour respecter les engagements européens de la France, notamment la liberté de circulation des capitaux. L’Union européenne reconnaît en effet aux États membres, dans son règlement sur le filtrage des investissements directs étrangers (règlement UE 2019/452), le droit de mettre en place des dispositifs de contrôle à condition qu’ils soient proportionnés, transparents et non discriminatoires.
À ce titre, le régime français de contrôle des investissements étrangers constitue une application rigoureuse mais légitime de cette compétence nationale et exclusive reconnue aux États, mais dans le cadre d’un dialogue permanent avec les partenaires européens.
Vers une doctrine française du contrôle des investissements étrangers
Sur les fondements de l’article L151-3 du Code monétaire et financier, la France s’est dotée d’un outil spécifique du contrôle des investissements étrangers, fondé sur un équilibre subtil entre souveraineté, sécurité et attractivité. Cette doctrine se traduit par une réglementation évolutive, des lignes directrices précises, des exigences de transparence procédurale et un dialogue continu avec les investisseurs.
La publication régulière de rapports annuels et la mise à jour des secteurs concernés montrent la volonté des autorités d’adapter leur doctrine aux mutations économiques et géopolitiques du monde contemporain.
L’article L151-3 du Code monétaire et financier constitue bien plus qu’un simple outil juridique : il est l’expression d’une souveraineté assumée face à la mondialisation. En plaçant la défense de ses intérêts fondamentaux au cœur du contrôle des investissements étrangers, la France se donne les moyens d’arbitrer entre ouverture économique et sécurité économique. À travers cette disposition, elle affirme que la liberté d’investir ne saurait se faire au détriment de sa capacité à préserver l’intégrité de son tissu économique et technologique.
Quels sont les liens utiles concernant le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) ?
La page dédiée de la Direction générale du Trésor du Ministère de l’Economie et des finances
Le site de Téléservice du Contrôle des Investissements Etrangers en France (IEF)
La plateforme Contrôle des Investissements Etrangers en France (IEF) permet de déposer une demande d’autorisation préalable d’investissement étranger, en application de l’article R. 151-3 du code monétaire et financier.
https://plateforme-ief.dgtresor.gouv.fr/
Les lignes directrices du ministère de l’Economie
Lignes directrices relatives au controle des investissements étrangers en France – IEF
Pour en savoir plus
Livre « IEF Le contrôle des investissements étrangers en France », ed Relians, 2024
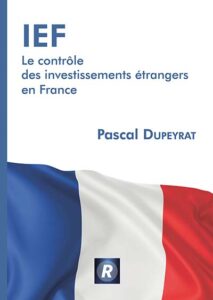
Notre expertise
Relians, cabinet de conseil stratégique et institutionnel, accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises confrontées à ces enjeux. En s’appuyant sur une lecture experte des textes, des pratiques administratives et des lignes directrices applicables, nous aidons nos clients à structurer leurs opérations en toute sécurité, dans le respect des exigences réglementaires et dans une logique de dialogue constructif avec les autorités françaises.
Relians, spécialiste du contrôle des investissements étrangers
